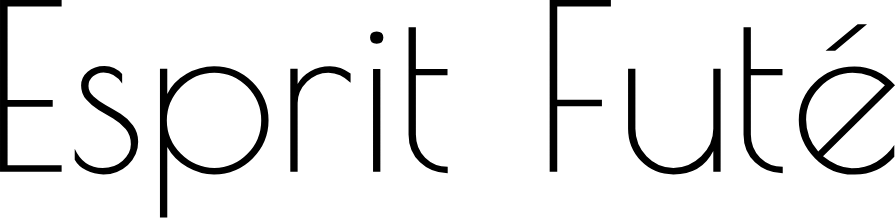Le miroir trouble de nos existences
Il arrive parfois, au détour d’un moment sans artifice, que notre regard croise celui d’un inconnu, dans un train, un bistrot ou un couloir d’hôpital. Pas un simple échange de politesses, non — un regard qui attrape, qui trouble, qui renvoie. Et dans ce bref instant naît un trouble étrange, comme si l’on venait de voir son propre reflet dans une glace déformante. Pourtant, ce n’est pas nous : cet autre est bien réel, extérieur. Mais ce que nous percevons, ce que nous ressentons… est-ce réellement lui ? Ou portons-nous, inconsciemment, un masque à l’autre, un décalque de nos obsessions, de nos peurs, de nos blessures ? C’est là que surgissent les projections inconscientes.
La plupart du temps, elles se coulent en nous comme des sédiments invisibles. Des jugements rapides, des attractions fulgurantes, des aversions sans raison rationnelle. Nous croisons un collègue trop sûr de lui et notre estomac se crispe : arrogance ? Peut-être. Ou peut-être que son aplomb vient déranger une faille secrète, une envie abandonnée en nous. Car les projections, comme des mains invisibles, manipulent nos relations, colorient nos rencontres, faussent nos amours. Elles sont légions dans notre théâtre intime, et pourtant, nous refusons souvent de les interroger.
Il s’agit ici de franchir la membrane de confort. Non pour corriger, améliorer ou “devenir la meilleure version de soi” — formule creuse d’une époque hypertrophiée par l’ego — mais pour reconnaître que bien souvent, nous ne voyons pas l’autre : nous nous voyons en lui. Et que cette distorsion du réel n’est pas anecdote psychologique, mais réalité existentielle.
Partons donc explorer ce territoire mouvant et vertigineux des projections inconscientes : comment elles naissent, comment elles façonnent notre perception de soi et des autres, et comment elles nous enferment plus sûrement que n’importe quel préjugé social. L’enjeu n’est pas l’éradication, ni la maîtrise. L’enjeu, c’est la lucidité nue — cet art rare et exigeant de voir. Non pas à travers, mais au-delà.
Les origines souterraines — une mécanique ancestrale de l’ego
La projection inconsciente n’est pas une invention moderne, ni même spécifiquement psychologique. Elle plonge ses racines jusque dans nos origines les plus archaïques, celles où le cerveau reptilien gouvernait le monde par simple stimulus-réaction. À ce stade, l’autre n’existait que par ce qu’il évoquait, en nous, de danger ou de désir. Cette stratégie primitive de survie — simplifier l’autre pour mieux réagir — est restée en nous, mais s’est raffinée, recouverte d’écrans culturels, de récits identitaires, de vernis moraux.
Freud fut peut-être le premier à formuler le concept de manière explicite, mais c’est Jung qui l’a véritablement cartographié dans toute sa profondeur : “Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes.” L’ombre jungienne, cette part de nous que nous refusons de reconnaître, trouve dans la projection un théâtre d’expression fécond. Ce que nous n’osons pas admettre en nous, nous l’exilons en dehors. Nous l’habillons d’un corps, d’un visage, d’une posture. Et nous le jugeons de l’extérieur, croyant encore nous préserver.
Curieusement, cette mécanique n’est pas que l’apanage de l’individuel. Certaines civilisations tout entières ont fonctionné sur des projections collectives. L’orientalisme, tel que déconstruit par Edward Said, n’est rien d’autre qu’une grande projection de fantasmes et de peurs occidentales sur un “Orient” mythifié, sexualisé, dépolitisé. Même aujourd’hui, dans certaines représentations de l’étranger, on retrouve les exacts archétypes refoulés de sociétés “civilisées” : violence, passion, irrationalité. Comme si l’Autre permettait de projeter ce que le groupe dominant cherchait à étouffer.
Un anecdote significative me revient. En 2015, dans un quartier de Barcelone, une femme âgée avait accusé un jeune migrant subsaharien de tentative de vol. Il s’avéra, après enquête, qu’il l’avait simplement soutenue alors qu’elle trébuchait. Interrogée plus tard, bouleversée, elle déclara : “Je ne sais pas pourquoi j’ai cru qu’il voulait me faire du mal… Il m’a fait penser à quelqu’un d’autre.” Ce “quelqu’un d’autre”, c’était une image floue, transmise par les mille micro-récits médiatiques, culturels ou familiaux. Une projection plus tenace que le réel.
Sous quelle forme se manifestent vos propres projections ? Quelles émotions — gêne, admiration, colère — surgissent face à certaines personnes et que disent-elles, en creux, de vous-même ?
L’attraction déformante — quand l’amour n’est qu’un miroir
On croit tomber amoureux de l’autre… mais souvent, on tombe amoureux de ce qu’on projette sur lui. Cette phrase, entendue un jour dans la bouche d’une comédienne vieillissante lors d’un festival de théâtre alternatif, m’a heurté autant qu’elle m’a éclairé. L’amour, ce lieu sacré d’abandon, est aussi le terrain de jeu favori des projections inconscientes. Nous ne voyons pas l’autre tel qu’il est, mais tel que nous aurions voulu qu’il soit — tel que nous avons besoin qu’il soit.
Ainsi se forment les grandes romances destructrices : non parce que l’autre est “toxique”, mot galvaudé à souhait, mais parce qu’à un moment, l’image projetée se fissure. Et cela, nous ne le supportons pas. Nous lui en voulons d’avoir cessé d’incarner le rôle que notre psyché lui avait attribué. C’est toujours la même mésaventure : nous ne tombons pas amoureux, nous tombons dans le piège de nos manques.
Dans le mythe grec de Narcisse, souvent mal compris, le jeune homme ne meurt pas parce qu’il s’aime trop. Il meurt de ne voir que lui dans le reflet du monde. Écho, la nymphe qui l’aime sincèrement mais sans visage propre, est condamnée à répéter les derniers mots de l’autre. Cette dynamique tragique nous hante encore : l’un projette, l’autre s’efface.
Une chercheuse en neurosciences affectives, Helen Fisher, a montré que le coup de foudre activait les mêmes zones du cerveau que l’addiction. Mais ce que l’on oublie de dire, c’est que ce “flash” initial s’appuie sur une construction intérieure — un archétype, souvent forgé dans l’enfance, un besoin mal comblé, parfois transgénérationnel. Nous reconnaissons en l’autre non pas quelque chose de lui, mais quelque chose de nous.
Prenons le cas de Chloé, trente ans, rencontrée lors d’un séminaire d’écriture au Maroc. Elle vivait une passion absolue avec un photographe qu’elle disait “vibrant, insaisissable, fascinant”. En réalité, après plusieurs mois, elle relut ses propres journaux de l’époque. L’homme n’apparaissait presque jamais. Elle ne parlait que d’elle : de ses attentes, de ses peurs, de son besoin de se sentir unique. L’autre n’avait été qu’un prétexte d’intensité.
Avez-vous déjà aimé une version de vous-même à travers la peau de l’autre ? Quels visages du passé cherchez-vous encore dans le présent ?

L’agacement révélateur — ce que nous détestons omet de nous dire
Le miroir ne reflète pas que le désir : il est aussi le mausolée de nos haines. Le franc-parler d’un inconnu nous exaspère ? Son arrogance probable, bien sûr. Mais si cela persistait, obstinément ? Peut-être y aurait-il là une part de vérité indicible. Une jalousie inavouée. Une frustration d’avoir dû toujours se taire, être mesuré, agréable.
Là encore, les projections opèrent par déplacement. Ce qui est insupportable chez l’autre est, souvent, une part de nous-mêmes que nous refoulons : nos pulsions agressives, nos envies d’indépendance, nos aspirations contradictoires. C’est le concept du “bouc émissaire” : chargeons l’autre de ce que nous ne pouvons pas voir en silence.
Un fait divers fascinant, survenu en Finlande en 2022, a mis en lumière cette logique. Un employé de bureau au comportement apparemment irréprochable fut suspendu après que ses collègues eurent relayé d’étranges accusations de “malaise” en sa présence. Enquête : il était simplement… trop silencieux. Son attitude renvoyait chacun à un inconfort existentiel — à leur propre vacuité professionnelle peut-être. Il ne faisait rien, et pourtant, il dérangeait. Le mutique devenait le catalyseur des projections bruyantes des autres.
Pierre Bourdieu avait cette intuition : “Le goût, c’est l’horreur du goût des autres.” Nous rejetons parfois non pas ce qui est objectivement mauvais, mais ce qui nous rabat à nos propres incertitudes. Ainsi, mépriser telle manière de parler, d’aimer, de croire — c’est souvent épingler un manque ou un désir que l’on voudrait taire.
À quels traits, quels gestes, quels types humains dites-vous “jamais” — et si cette parole était une tentative désespérée d’exorcisme ?
La lucidité comme acte de résistance — voir, sans détourner les yeux
Alors que faire ? Se méfier de tout, suspecter chaque élan, chaque attirance, chaque irritation ? Non. Surtout pas sombrer dans un scepticisme cynique. Mais apprendre à regarder — intensément. Lentement. Réapprendre à observer le présent sans réagir immédiatement. Trouver, dans le trouble qu’il provoque, un espace de questionnement plutôt que de jugement.
La lucidité, ici, n’est pas un outil. Elle est une posture intérieure, un art de l’accueil. Voir que ce que je projette sur l’autre me renseigne toujours davantage sur moi n’est pas une conclusion défaitiste, mais un passage. Une brèche. L’autre cesse alors d’être une silhouette que je peux manipuler, séduire ou diaboliser ; il devient un miroir complexe, redoutable, précieux.
C’est dans le stoïcisme antique, notamment chez Marc-Aurèle, que cette idée trouve une forme de transcendance : “Ce qui te trouble, ce n’est pas la chose, mais le jugement que tu portes sur elle.” La projection est ce jugement instantané, rarement interrogé. En le suspendant — ne fût-ce qu’un instant — un espace se crée. Une liberté, peut-être minuscule, mais réelle.
Je me souviens d’un prisonnier rencontré dans un cercle de lecture organisé en maison d’arrêt. Lui, condamné pour violence grave. Moi, venu là avec mes idées sur le “profil type”. Après plusieurs semaines, je compris combien mes propres projections m’avaient empêché de l’écouter. L’homme parlait poésie, silence, enfance — et moi je guettais l’agressivité. Elle n’était nulle part, sauf peut-être… en moi.
Et si apprendre à reconnaître nos projections était déjà un pas immense vers la liberté ? Cette liberté de ne pas plaquer sur l’autre une explication trop simple. Ce courage de rester dans le non-savoir, l’écoute nue.
La neige obscure de nos regards
Ce que nous projetons ne disparaît jamais vraiment ; cela change de forme. Il n’y a pas purification, mais possibilité — celle d’accueillir nos figures intérieures sans les graver sur le monde. Comme s’il était temps, enfin, de retirer la pellicule colorée qui habille nos relations, pour apercevoir, ne serait-ce qu’un instant, la nudité de l’autre.
Si l’on veut connaître véritablement quelqu’un, il faut commencer par remettre en question ce que l’on croit voir de lui. Non pour tomber dans l’informe, mais pour habiter cette terre instable de la relation vécue. Dans cette instabilité repose notre chance — celle d’un contact réel.
Nos projections sont des mythes flottants, des récits créés par un inconscient trop bavard. Mais l’on peut apprendre à les écouter. Non pas pour leur donner raison, mais pour y entendre les contours de nos blessures, nos désirs tus, nos colères anciennes. Ce sont des cartographies sauvages, et parfois, elles nous guident là où la conscience ordinaire ne sait pas aller.
Alors, peut-être faudrait-il, chaque jour, se poser cette question simple mais redoutable : ce que je ressens à propos de l’autre — est-ce bien à lui que cela appartient ? Ou suis-je encore en train de me raconter moi-même, sur sa peau ?
Et vous, quelle part de ce sujet vous interpelle ? Partagez votre réflexion ou poursuivez l’exploration avec nos autres articles…