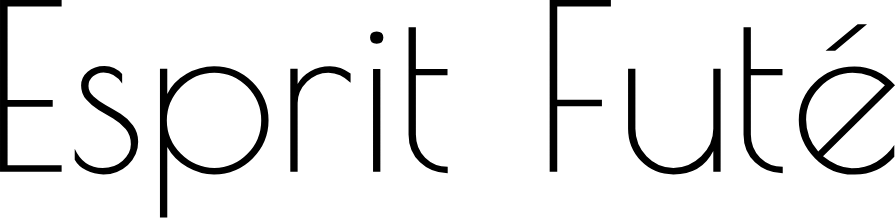Et si penser n’était pas (seulement) une affaire de neurones ?
Fermez les yeux. Imaginez une tasse de café brûlante entre vos mains. Le contact, la chaleur, le poids. Vous n’avez pas besoin de réfléchir pour la sentir — et pourtant, ce geste, banal en apparence, active en vous une cascade de processus cognitifs. Vous la sentez, vous la jugez, vous l’anticipez. Et tout cela, avant même de penser le mot « café ».
Et si la pensée n’émergeait pas seulement du cerveau, mais de la chair, du muscle, du nerf ? Si notre intelligence ne se logeait pas uniquement dans nos synapses, mais dans notre posture, notre respiration, notre gestuelle ? La « cognition incarnée » bouleverse l’héritage cartésien : elle postule que l’esprit est profondément enraciné dans le corps. Elle ne réduit pas la pensée à une activité cérébrale, mais l’étend à l’expérience vécue, aux sensations, à la motricité. Une révolution silencieuse est à l’œuvre. Cet article en explore les contours.
L’origine du tournant incarné : quand le corps entre dans la cognition
Pendant des siècles, la pensée occidentale a cultivé un dualisme obstiné : le corps d’un côté, l’esprit de l’autre. L’un pesant, mortel, pulsionnel ; l’autre subtil, abstrait, rationnel. Le cerveau y était roi, les mains simples exécutantes. Mais depuis les années 1990, un courant interdisciplinaire a remis ce modèle en cause.
Les travaux fondateurs de Francisco Varela, Eleanor Rosch et George Lakoff, menés entre les années 1980 et 1990, ont radicalement reconfiguré notre compréhension de la cognition. En 1991, dans leur ouvrage commun The Embodied Mind, publié à Boston, Varela et Rosch (avec Evan Thompson) introduisent la notion selon laquelle la cognition est enracinée dans notre corporéité, notre perception située et notre interaction dynamique avec l’environnement. Parallèlement, George Lakoff, à l’université de Californie à Berkeley, publie avec le philosophe Mark Johnson Metaphors We Live By (1980), puis Philosophy in the Flesh (1999), démontrant que les concepts abstraits — comme le temps, le pouvoir ou l’affection — ne flottent pas dans une sphère purement logique, mais sont façonnés par des schémas sensorimoteurs. Dire « je suis sous pression », « je vais de l’avant », ou « je prends du recul » ne relève pas de la simple métaphore stylistique : ce sont des empreintes directes de nos interactions physiques projetées dans notre langage. Le corps fournit des structures conceptuelles primaires, le langage les module, et la pensée y prend forme. Ce que nous croyons être des idées abstraites est en réalité profondément informé par la structure incarnée de notre expérience. Autrement dit : nous pensons avec nos pieds, nos mains, notre torse, et nos trajectoires dans l’espace.
Question ouverte : dans vos propres formulations, combien de métaphores sont enracinées dans une expérience sensorielle ou spatiale ?
Quand le mouvement éclaire la pensée : corps en action, esprit en extension
Prenez une craie et écrivez une équation sur un tableau. Ce simple geste mobilise bien plus que la coordination œil-main : il engage votre posture, votre équilibre, la spatialisation du problème dans l’environnement. Et il facilite… la résolution du problème lui-même. En 2007, une étude dirigée par Sian Beilock à l’Université de Chicago a démontré que les étudiants qui utilisaient des gestes pour expliquer un problème mathématique en retenaient mieux les mécanismes que ceux qui restaient immobiles. D’autres recherches, comme celles menées par Susan Goldin-Meadow dans les années 2000, ont mis en lumière le rôle central du mouvement dans la consolidation des apprentissages abstraits. Le corps, loin d’être un simple véhicule de l’intellect, en devient le catalyseur silencieux, traducteur de l’idée en action, révélateur de liens implicites entre représentation spatiale et raisonnement symbolique.

Dans certaines classes Montessori ou dans les pédagogies alternatives, les enfants apprennent en manipulant, en se déplaçant, en sentant. Ce n’est pas un hasard : dès les années 1960, Maria Montessori avait observé que le mouvement volontaire engageait des fonctions supérieures de l’intelligence, bien avant que les neurosciences ne le confirment. Aujourd’hui, des études récentes en neuroéducation montrent que les connaissances acquises par l’action — manipulations concrètes, jeux sensorimoteurs, exploration physique — s’ancrent plus profondément et sont plus facilement réutilisables. En 2015, une méta-analyse publiée dans Frontiers in Psychology par Kiefer & Trumpp a mis en lumière le rôle du système moteur dans l’activation des concepts abstraits. Lorsque les enfants tracent une lettre en grand format avec le bras entier, par exemple, ils n’activent pas seulement la mémoire visuelle, mais aussi les circuits proprioceptifs et moteurs associés à la forme. Ainsi, l’apprentissage devient une chorégraphie cognitive où la mémoire procédurale, la compréhension symbolique et la perception sensorielle coopèrent activement.
Micro-exercice : refaites un raisonnement complexe en marchant lentement. Observez si des idées nouvelles émergent.
Le corps comme carte mentale : perceptions, gestes et représentations
Une autre avancée majeure vient des travaux sur la perception spatiale, notamment ceux menés par Dennis Proffitt à l’Université de Virginie dans les années 1990 et 2000. Il apparaît que nos représentations du monde sont profondément liées à notre position corporelle dans l’espace. Proffitt a montré, par exemple, que des participants percevaient une colline comme plus raide lorsqu’ils étaient fatigués ou portaient un sac à dos lourd. Dans une autre étude, la distance perçue à un objet variait selon que les participants le tenaient ou non dans la main, suggérant que notre système perceptif intègre implicitement la capacité à agir sur l’environnement pour moduler la perception elle-même. Plus encore : des recherches complémentaires, comme celles de David Casasanto, indiquent que la perception du temps peut également être influencée par notre posture ou notre sens de l’action. Ainsi, être penché en avant ou recroquevillé peut affecter la manière dont nous estimons la durée d’un événement. Ces résultats renforcent l’idée que la perception n’est pas passive : elle est continuellement ajustée par l’état du corps.
Nos mains, nos yeux, notre tronc orientent notre compréhension du réel. Le corps n’est pas un outil extérieur à la pensée — il en est la trame implicite. Il façonne nos cartes mentales. Ce que nous appelons « vision du monde » est d’abord une vision incarnée, située, sensorielle. L’abstraction pure est une illusion : même nos plus hautes élaborations intellectuelles s’enracinent dans des schèmes perceptifs corporels. Le philosophe américain Mark Johnson, professeur à l’Université de l’Oregon et collaborateur de George Lakoff, a consacré une large partie de sa carrière, notamment dans The Body in the Mind (1987), à démontrer que nos raisonnements reposent sur des structures préconceptuelles issues de l’expérience physique : la verticalité, la contenance, le mouvement vers un but. Ces structures, appelées « image schemas », forment l’ossature silencieuse de notre pensée rationnelle. Autrement dit, pour comprendre ce qu’est une idée, il faut parfois commencer par comprendre ce qu’est une marche, une pression ou une trajectoire vécue.
Exploration personnelle : que se passerait-il si vous changiez volontairement de posture pour aborder une situation familière ?
Des émotions au raisonnement : la chair du jugement
L’intelligence ne se résume pas à calculer. Elle implique de sentir, d’évaluer, de trancher. Or, cette capacité de jugement — souvent associée à la froide logique — est profondément influencée par l’état corporel. Ce phénomène est connu sous le nom d’embodiment affectif, ou incarnation affective : une perspective en psychologie cognitive qui souligne que nos états émotionnels, physiologiques et posturaux modulent nos évaluations et nos décisions, souvent de façon inconsciente. Par exemple, une posture corporelle expansive peut renforcer la confiance en soi et la propension à prendre des risques, tandis qu’un état de fatigue ou de stress physiologique peut accentuer le biais de précaution ou d’évitement. Loin d’être une coquetterie de laboratoire, l’embodiment affectif a été largement documenté depuis les années 2000 dans des études empiriques en psychologie expérimentale et en neurosciences affectives, notamment dans les travaux de Antonio Damasio et de Gerald Clore. La peur, la faim, la fatigue, la tension musculaire ou même la température ambiante influencent directement nos prises de décision, non par caprice, mais parce qu’ils altèrent les signaux corporels que le cerveau utilise pour estimer l’urgence, la sécurité ou la pertinence d’un choix à faire. C’est la chair qui colore le jugement, avant que la raison ne le justifie.
Une étude célèbre menée en 2011 par Shai Danziger, Jonathan Levav et Liora Avnaim-Pesso à l’université Ben Gourion (Israël), publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, a révélé que les juges siégeant dans des tribunaux de libération conditionnelle accordaient significativement moins de permissions de sortie avant la pause déjeuner. La variable explicative ? Leur taux de glucose, influençant inconsciemment leur sévérité. Par ailleurs, dans une série d’expériences menées par Dennis Proffitt dans les années 2000, il a été démontré qu’une personne légèrement inclinée vers l’arrière jugeait une situation comme moins menaçante que si elle était penchée en avant. Le corps ne se contente donc pas de « ressentir » : il produit des biais cognitifs, certes, mais également des signaux d’ajustement qui influencent activement nos jugements. Qu’il s’agisse de décisions morales, politiques ou esthétiques, ceux-ci s’élaborent à l’intersection subtile entre l’état interne du corps et la perception contextuelle. C’est la chair, en somme, qui nuance et colore la pensée.
L’esprit distribué : penser, c’est étendre son intelligence hors du crâne
La cognition incarnée ouvre sur une perspective plus radicale encore : celle d’une cognition distribuée. Selon cette hypothèse développée notamment dans les années 1990 et 2000, penser ne se limite pas à ce qui se passe à l’intérieur du cerveau, mais implique une interaction dynamique entre le cerveau, le corps, les objets et l’environnement. L’un des exemples les plus parlants est celui du calcul sur les doigts chez les enfants — et parfois chez les adultes. Ce geste, loin d’être anecdotique, externalise une partie du traitement cognitif, réduisant la charge mentale et augmentant la précision. De même, lorsque l’architecte esquisse un plan, il ne projette pas une idée préexistante sur un support neutre : c’est dans l’interaction entre sa main, le crayon, la surface, que la pensée architecturale prend forme. Le support devient alors un partenaire cognitif, un espace de feedback, de projection et de remaniement en temps réel. En 2005, l’équipe de recherche de Stephen J. Lupfer et Edwin Hutchins a mis en évidence ce phénomène dans des environnements techniques complexes comme les cockpits d’avion, montrant que les outils et l’environnement jouent un rôle actif dans la résolution de problèmes. Le support n’est donc pas un simple enregistrement passif de la pensée : il en est une extension, parfois même une condition émergente.
Andy Clark, philosophe et spécialiste des sciences cognitives à l’Université d’Édimbourg, défend dans son ouvrage Supersizing the Mind (2008) une idée aussi déroutante que stimulante : le mental ne s’arrête pas à la boîte crânienne. Selon lui, les processus cognitifs s’étendent au-delà du cerveau pour inclure le corps et l’environnement matériel. Le mental, loin d’être une bulle isolée, serait un système distribué, interactif, évolutif. Dans ses recherches menées dans les années 2000 en lien avec David Chalmers, il introduit la thèse de l’extended mind, selon laquelle une feuille de papier, un smartphone ou un carnet peuvent faire partie intégrante de notre pensée si nous les utilisons de manière fluide pour accomplir une tâche cognitive. Cette vision brouille les frontières traditionnelles entre esprit et monde. Elle défait le mythe d’un « moi pensant » isolé. Elle suggère que penser, c’est aussi synchroniser — son souffle, ses appuis, ses gestes, ses outils avec la complexité mouvante de l’environnement. Penser, c’est s’incarner, certes, mais aussi s’augmenter, s’adapter, s’articuler dans un monde matériel qui participe activement à l’élaboration de la pensée.
Question ouverte : quelles sont vos extensions cognitives ? Un carnet, un mur, un corps en mouvement ?
Et si nous pensions d’abord avec nos muscles ?
La cognition incarnée ne relègue pas le cerveau. Elle l’élargit, le décentre, le connecte à la chair du monde. Elle le replace dans une boucle sensorimotrice où le corps, loin d’être un simple relais périphérique, devient un partenaire actif et modulant du raisonnement, de la mémoire, de l’émotion. Dans cette perspective, chaque sensation, chaque tension musculaire ou variation de posture participe activement à l’architecture de nos idées. L’intelligence ne se fabrique pas uniquement dans les synapses, elle s’improvise dans l’équilibre d’un mouvement, se nuance dans un soupir, s’oriente dans un appui. Penser, dès lors, n’est plus un acte solitaire de l’esprit, mais une symphonie incarnée, un dialogue constant entre ce que l’on sent, ce que l’on fait et ce que l’on comprend.
Reconnaître cette co-agence entre le corps et l’esprit, c’est ouvrir une voie vers une compréhension plus organique, plus ancrée de la pensée. C’est peut-être aussi, dans un monde de plus en plus numérisé et désincarné, retrouver une forme de sagesse sensorielle oubliée. Car si notre esprit flotte parfois, notre corps, lui, sait. Il se souvient. Il anticipe. Il parle — souvent avant nous. Encore faut-il apprendre à l’écouter.
Dernier exercice : repérez aujourd’hui une situation où votre corps a su avant votre esprit. Que disait-il ? Et l’avez-vous entendu ?
📣Votre corps a‑t-il vibré à cette idée d’une intelligence incarnée ?
- Racontez en commentaire une de ces sagesses silencieuses de votre chair, qu’elle vous ait éclairé ou induit en erreur.
- Pour ne rien perdre de nos explorations sensorielles de la pensée, abonnez-vous à notre newsletter.
- Et pour prolonger cette écoute intérieure, nos articles sur la proprioception, les émotions viscérales et la mémoire corporelle vous attendent.