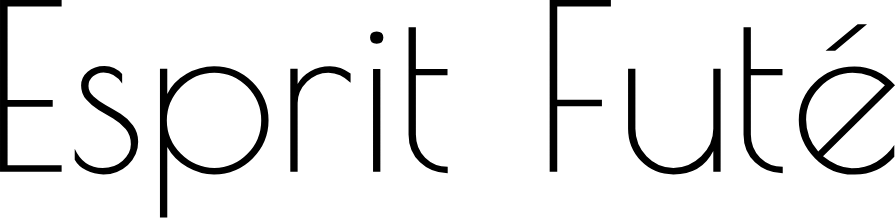Quand l’esprit choisit avant nous
Imaginez. Vous êtes assis à votre bureau, concentré, et soudain, une phrase vous traverse l’esprit : « J’ai oublié d’envoyer cet e‑mail. » Ce surgissement de pensée semble naturel, quasi banal. Mais arrêtez-vous un instant. Qui, ou quoi, a généré cette pensée ? D’où vient-elle réellement ? L’avez-vous choisie ?
Intuitivement, nous nous considérons comme les auteurs de notre flux mental. En guise de spectateurs-acteurs de notre théâtre intérieur, nous nous félicitons de certaines pensées (« Ça, c’est une bonne idée ! »), et nous blâmons ou refoulons d’autres (« Quelle horreur d’avoir pensé ça… »). Cette position d’observateur-auteur, ancrée dans la culture occidentale depuis Descartes, nous flatte : elle suppose une volonté rationnelle, éclairée et souveraine.
Pourtant, depuis les années 1980, des expériences dérangeantes ont fissuré cette certitude. L’impression que nous contrôlons nos pensées et nos décisions pourrait bien être une fiction mentale, inventée a posteriori. Ce que nous ressentons comme la cause consciente d’une action pourrait n’être qu’un effet, un récit narratif greffé par le cerveau pour rendre cohérente une action qui, en réalité, a déjà été initiée ailleurs, autrement.
Face à cette idée – nous ne décidons pas consciemment ce que nous pensons, ressentons ou même faisons – une étonnante résistance s’élève. Car remettre en question cette illusion, c’est perdre une forme de confort existentiel. C’est s’avouer, en partie, marionnette de ses propres automatismes.
Ainsi commence une exploration déroutante : et s’il n’y avait personne aux commandes ?
L’expérience Libet : une fêlure dans la volonté
C’est en 1983 que Benjamin Libet, neurophysiologiste américano-tchèque, électrifie la communauté scientifique. Son expérience célèbre consiste à demander à des participants de bouger un doigt « quand ils le décident », tout en enregistrant l’activité électrique de leur cerveau.
Résultat ? Le « potentiel de préparation » – une onde cérébrale annonçant l’action – apparaît jusqu’à 350 millisecondes avant que le participant n’ait conscience de sa décision de bouger. La conscience agit donc après le cerveau.
L’expérience a fait couler des océans d’encre. Certains y voient la preuve que le libre arbitre est une illusion, d’autres défendent une forme de « veto conscient » : nous ne choisissons pas d’agir, mais nous pouvons empêcher l’action. Cependant, l’implication majeure reste souvent évitée : entre le moment où le corps se prépare à agir et celui où nous en prenons conscience, un gouffre de fonctionnement automatique s’ouvre.
Pas besoin de mouvements musculaires : dans des expériences récentes reproduisant le protocole de Libet, on observe des potentiels similaires pour des décisions mentales abstraites – choisir un mot, faire un calcul, répondre par oui ou non.
La pensée elle-même n’est peut-être qu’un effet secondaire d’un mécanisme qui a déjà initié le processus.
La prochaine fois qu’une idée « vous vient », demandez-vous vraiment : l’ai-je pensée, ou l’ai-je reçue ? D’où me vient-elle, dans l’espace du mental ?
L’invention du sentiment d’auteur : quand l’esprit fabrique le moi
Dans les années 2000, le chercheur Daniel Wegner popularise une idée fondamentale : la « théorie du sentiment d’auteur » (theory of apparent mental causation). Selon lui, notre cerveau fabrique une illusion d’intentionnalité, notamment lorsqu’il anticipe correctement le résultat d’une action.
Un exemple ? Si je tends la main pour attraper une tasse, et que je sens le contact sous mes doigts, j’ai l’impression d’avoir voulu ce geste. Or, cette sensation vient de la prédiction officielle du cerveau : il avait ‘prévu’ que cela devait se produire. Si le résultat concorde avec la prédiction, le cerveau déduit que j’en suis l’agent.
Mais quand il y a un décalage entre intention et résultat, ce sentiment d’auteur peut disparaître… ou se réattribuer ! Dans l’illusion bien connue de l’« automatisme idéomoteur » – comme la planche Ouija –, des participants croient que le curseur bouge tout seul. En réalité, ce sont eux qui le déplacent inconsciemment. Tout repose sur la non-perception de leurs propres micro-actions et une attribution erronée : « Ce n’est pas moi. »
Le sentiment d’être l’auteur d’une action ou d’une pensée dépend bien plus de la cohérence narrative post hoc que d’un contrôle réel et central. Nous sommes les scénaristes d’un film déjà en train de se jouer.
Exercice d’observation cognitive : Notez, durant une journée, combien de pensées vous viennent sans effort. Quelles pensées revendiquez-vous ? Lesquelles rejetez-vous ? Qui parle vraiment ?
L’auto-narration comme faux gouvernail
Chaque jour, nous construisons le récit de nous-mêmes. Nous nous racontons : nos raisons, nos choix, nos intentions. Mais ces « raisons » sont souvent reconstruites a posteriori. Dans une célèbre expérience conduite par Nisbett et Wilson (1977), les participants doivent choisir entre plusieurs bas de nylon (identiques). Tous ou presque choisissent ceux de droite, et quand on leur demande pourquoi, ils donnent des justifications liées à la texture ou à la couleur. Aucun ne mentionne que leur choix a été biaisé par la position spatiale.
Le cerveau excelle dans l’art de rationaliser après coup.
Ce mécanisme n’est pas mensonger : il est inconscient. Notre esprit narratif construit une histoire plausible pour expliquer une action déjà décidée ailleurs, dans les couches profondes, implicites, heuristiques de l’encéphale.
Dans cette perspective, la volonté n’est pas la force d’un capitaine éclairé, mais le sillage laissé par un navire automatique, que l’on regarde après coup en se disant : « C’est moi qui ai dirigé. »
Et si la volonté n’était qu’un effet secondaire de la mémoire ? Autrement dit, une reconstruction de pourquoi on a fait ce qu’on a déjà fait.
Intelligence artificielle, fourmis et poésie neuronale
À l’ère des intelligences artificielles génératives, une analogie fascinante émerge : et si notre pensée ressemblait aux architectures distribuées, sans chef d’orchestre ? Comme les IA qui produisent des textes sans comprendre, notre propre discours mental pourrait n’être rien de plus qu’un output statistique de micro-agents internes.
La comparaison avec les colonies de fourmis éclaire cette idée. Les fourmis, individuellement très limitées, produisent collectivement des architectures complexes, sans hiérarchie centrale. Pas besoin de chef : des signaux locaux suffisent.
Le philosophe Daniel Dennett a déjà suggéré que notre conscience fonctionne pareil : émergente, distribuée, sans siège fixe. C’est une poésie neuronale, pas une salle de contrôle.
Alors, si l’esprit est une fédération de tendances, d’associations, de prédictions, peut-on encore croire que le “je” règne ? Ou serait-il une fiction utile, comme une étiquette collée sur une bouteille vide pour lui donner un sens ?
Micro-expérience mentale : Imaginez que toutes vos pensées soient générées par des modules indépendants, que vous ne contrôlez pas. Quel mot pourriez-vous utiliser pour décrire « vous-mêmes » ? Existe-t-il encore un “je” ?
Un roi nu dans un palais sans trône
L’illusion de la volonté n’a rien d’anecdotique. Elle est peut-être la plus grande supercherie évolutive, une fonction de cohésion sociale plus qu’un reflet de réalité. Croire que nous décidons nous-mêmes de nos pensées, c’est donner corps à un mythe structurant.
Mais ce mythe est utile — au moins, il l’a été. Il protège notre responsabilité sociale, justifie nos actes, renforce nos préférences, forge le lien entre l’acte et la personne. Pourtant, lorsqu’on ose le regarder en face, il s’effrite.
Cela ne signifie pas que tout est perdu. Un monde sans volonté centrale n’est pas un monde de chaos. C’est un monde d’émergences, d’ajustements, de tensions intracognitives. Un monde où l’on apprend à observer les flux qui passent en nous sans les confondre avec des décisions.
Le philosophe Bouddha disait : “Ce n’est pas moi qui pense – la pensée me pense.” Il ne parlait pas d’humilité. Il décrivait une lucidité.
Alors, à partir d’où pourrions-nous vivre, si ce n’est à partir du « je » ?
Et que se passerait-il si nous laissions les pensées venir, sans les croire, ni les combattre, ni les signer de notre nom ?
Ouvrez la fenêtre. Il n’y a peut-être personne à l’intérieur – et, étrangement, cela apaise.
-
Ne cherchez pas à savoir ce que vous pensez. Observez plutôt ce que pense l’esprit – et décidez, lentement, si cela vous appartient.
-
Abonnez-vous à notre newsletter pour des plongées régulières dans les mécanismes invisibles de la pensée humaine.
-
Quelle expérience personnelle ce sujet vous évoque-t-il ? Avez-vous déjà douté d’être l’auteur d’une de vos pensées ?